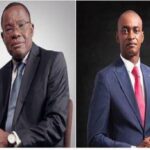Bien avant la colonisation, le Cameroun était une mosaïque de sociétés aux structures politiques diverses : royaumes centralisés au Nord, chefferies puissantes à l’Ouest et systèmes lignagers décentralisés au Sud et à l’Est. Cette diversité, loin d’être un obstacle, a façonné un terreau riche en valeurs de gouvernance et de participation. Ce blogpost explore ces modèles ancestraux et met en lumière leur influence sur la gouvernance contemporaine. Comment cette diversité politique a-t-elle contribué à la formation de l’État moderne camerounais ? Quelles pratiques traditionnelles pourraient être réhabilitées pour une démocratie plus inclusive ?
Des royaumes organisés aux chefferies segmentaires : un aperçu du Cameroun précolonial
Le territoire qui constitue aujourd’hui le Cameroun était, bien avant l’arrivée des puissances coloniales, une mosaïque politique riche et variée. Chaque région du pays disposait de systèmes politiques adaptés à ses réalités géographiques, économiques et sociales. Cette configuration a légué un patrimoine politique d’une grande complexité, fondement potentiel d’une gouvernance inclusive contemporaine.
Au Nord, on retrouvait des royaumes centralisés influencés par les grands empires sahéliens. Le Kanem-Bornou et les chefferies peules s’appuyaient sur des hiérarchies politiques très structurées, dirigées par des sultans ou des lamibés. Le pouvoir y était à la fois administratif, religieux et judiciaire. L’islam, véhiculé par les marchands et les conquérants, structura l’organisation de ces royaumes et encouragea la formation d’une élite administrative et lettrée, anticipant ainsi les bases d’une bureaucratie locale bien avant l’administration coloniale.
À l’Ouest, les chefferies bamiléké et bamoun formaient des royaumes solides autour de figures royales appelées fon ou mfon. L’exercice du pouvoir reposait sur un système de notables et de sociétés secrètes, assurant une répartition équilibrée du pouvoir et une forme de surveillance mutuelle. Ces systèmes étaient profondément enracinés dans la légitimité traditionnelle et fonctionnaient avec des mécanismes participatifs, bien que hiérarchiques.
Dans le Sud et l’Est, les peuples bantous et pygmées vivaient dans des sociétés lignagères plus égalitaires. Ces communautés segmentaires étaient gouvernées par des conseils d’anciens ou des chefs de clan, où les décisions se prenaient par consensus. Ce modèle, bien que moins spectaculaire que les monarchies, témoignait d’un exercice collectif du pouvoir et d’une démocratie à échelle locale.
Ce panorama politique précolonial révèle une chose essentielle : la gouvernance au Cameroun n’a pas été introduite par la colonisation, mais s’enracinait dans des traditions anciennes qui méritent aujourd’hui d’être revisitées.
Gouvernance traditionnelle et démocratie locale : quelles leçons pour aujourd’hui ?
L’un des apports majeurs de cette diversité politique précoloniale réside dans les valeurs qu’elle véhiculait : participation, représentativité, légitimité culturelle, équilibre des pouvoirs, et ancrage local. Ces piliers sont toujours pertinents pour construire une démocratie moderne adaptée aux réalités camerounaises.
D’abord, la collégialité et le consensus, typiques des sociétés segmentaires, sont des formes de participation citoyenne avant la lettre. Alors que les systèmes politiques contemporains peinent à impliquer les citoyens dans les processus décisionnels, ces traditions montrent que des formes de démocratie directe ont existé et peuvent encore inspirer les pratiques de gouvernance locale, notamment à travers les conseils municipaux ou régionaux.
Ensuite, les chefferies traditionnelles, bien que parfois perçues comme conservatrices, remplissent souvent un rôle essentiel de médiation sociale et de régulation communautaire. Le respect dont jouissent les chefs traditionnels dans certaines régions pourrait être institutionnalisé à travers une meilleure articulation entre pouvoir étatique et autorité coutumière, en renforçant la reconnaissance juridique de ces institutions comme cela a été amorcé par la loi camerounaise de 1977 sur les chefferies traditionnelles.
Par ailleurs, les royaumes organisés du Nord démontrent qu’un système centralisé peut coexister avec une forte participation communautaire, à condition d’enraciner le pouvoir dans la légitimité et le service du bien commun. Le recours à des conseils d’érudits, de religieux ou de notables est une pratique ancestrale qui pourrait inspirer la création de mécanismes consultatifs dans les politiques publiques actuelles, comme les forums citoyens ou les conseils consultatifs régionaux.
La gouvernance traditionnelle, loin d’être archaïque, contient donc des germes d’innovation démocratique. Les institutions camerounaises gagneraient à reconnaître et à intégrer ces logiques autochtones dans une approche de gouvernance plus inclusive, respectueuse des identités régionales, et fondée sur des pratiques éprouvées de dialogue et de délibération.
L’impact des structures politiques autochtones sur l’État moderne
Il serait erroné de considérer l’État camerounais contemporain comme un édifice purement colonial ou occidental. L’influence des structures politiques précoloniales est encore visible dans de nombreuses dimensions de la vie institutionnelle et sociale.
D’abord, la résilience des chefferies traditionnelles dans plusieurs régions atteste de leur pertinence. Non seulement elles ont survécu à la colonisation et à la centralisation post-indépendance, mais elles jouent toujours un rôle crucial dans la médiation sociale, la gestion foncière, et parfois même dans l’administration locale, notamment dans les zones rurales.
Ensuite, la stratification politique héritée des royaumes du Nord a contribué à façonner un appareil administratif structuré, où l’autorité est perçue comme légitime lorsqu’elle s’appuie sur des figures de sagesse et de compétence. Ce trait se retrouve dans la perception des élites politiques modernes, où l’attente populaire d’un leadership visionnaire puise dans ces imaginaires précoloniaux.
Plus largement, l’idée d’unité dans la diversité, essentielle à la construction nationale du Cameroun, prend racine dans cette hétérogénéité précoloniale. La coexistence historique de structures politiques différentes a préparé le terrain à une culture du compromis et du dialogue. Si la période coloniale a exacerbé certaines divisions, notamment entre francophones et anglophones, le socle traditionnel reste un modèle de gestion de la pluralité à redécouvrir.
D’ailleurs, les politiques publiques actuelles reconnaissent, même timidement, l’importance des institutions locales dans la gouvernance. Le processus de décentralisation engagé depuis la Constitution de 1996, bien que lent, s’inscrit dans cette logique de retour vers le local. La création des conseils régionaux en 2020, dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation, peut être lue comme une tentative de réhabilitation du rôle des communautés dans la gestion des affaires publiques.
Enfin, la Vision 2035 du Cameroun, document stratégique de planification nationale, insiste sur le développement d’une gouvernance inclusive et participative. Cela ouvre la voie à une valorisation des pratiques traditionnelles de concertation, à condition qu’elles soient encadrées par un cadre légal clair et équitable.
Conclusion : Réhabiliter le passé pour enrichir l’avenir
L’histoire politique précoloniale du Cameroun n’est pas qu’un souvenir folklorique ; elle est un gisement d’idées, de pratiques et de structures susceptibles d’enrichir la démocratie contemporaine. Plutôt que de voir la diversité des systèmes traditionnels comme un obstacle, il est temps d’y voir une source d’unité et d’innovation institutionnelle.
Face aux enjeux actuels de participation citoyenne, de légitimité politique et de cohésion nationale, la redécouverte de notre héritage politique ancestral peut contribuer à bâtir un modèle de gouvernance enraciné, inclusif et durable. Cela suppose une volonté politique forte, une reconnaissance institutionnelle des savoirs traditionnels et un dialogue entre passé et présent, entre modernité et tradition.
Le Cameroun, fort de son expérience historique, peut ainsi tracer une voie originale vers une démocratie à la fois authentique et fonctionnelle.
👉 Un livre bientôt disponible explorera en profondeur ces questions, avec des analyses historiques, politiques et économiques rigoureuses. Il s’intitulera « Cameroun : Une Démocratie en Voie de Développement ».
📬 Si vous souhaitez recevoir des contenus exclusifs, être informé dès la sortie du livre et accéder à des réflexions inédites sur la gouvernance et le développement du Cameroun, inscrivez-vous dès maintenant à notre newsletter. Vous ferez partie des premiers à découvrir cette œuvre scientifique destinée à tous ceux qui croient en un Cameroun plus juste, plus fort, et plus uni.
Ecrit par Vitalis Essala – Vitalis est pasteur-aumônier, auteur et analyste en gouvernance. Il écrit sur la démocratie, le développement et la résilience émotionnelle.