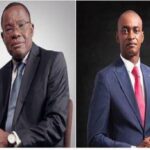Résumé :
Alors que le Cameroun poursuit son évolution démocratique, plusieurs axes de réforme émergent pour renforcer la transparence et la participation citoyenne. La modernisation du cadre électoral, la consolidation de l’État de droit et le renforcement de la gouvernance locale sont autant de leviers pour accompagner cette dynamique. Dans un contexte marqué par des défis sociopolitiques, cet article explore les perspectives d’amélioration en s’appuyant sur les avancées réalisées et les initiatives institutionnelles en cours, ouvrant ainsi la voie à une démocratie toujours plus inclusive et efficace.
La nécessité d’une réforme électorale transparente et indépendante
L’un des piliers de toute démocratie réside dans l’organisation d’élections libres, transparentes et crédibles. Le Cameroun, engagé depuis les années 1990 dans un processus de libéralisation politique, a progressivement mis en place des structures électorales, notamment Elections Cameroon (ELECAM), qui ont permis d’organiser des scrutins réguliers. Toutefois, malgré les avancées notables en matière de gestion logistique des élections, de nombreuses voix appellent aujourd’hui à une amélioration de l’indépendance institutionnelle et de la transparence du processus électoral.
L’un des enjeux majeurs reste la perception d’impartialité de l’organe en charge des élections. La nomination des membres d’ELECAM par décret présidentiel, bien qu’encadrée par la loi, soulève des interrogations sur l’autonomie réelle de l’institution. Afin de renforcer la confiance des citoyens et des acteurs politiques, plusieurs pistes peuvent être explorées, notamment l’élargissement des mécanismes de concertation entre partis politiques, société civile et pouvoir public pour superviser les opérations électorales.
Des réformes telles que la publication systématique des procès-verbaux bureau par bureau, l’amélioration de l’accès à l’information électorale, ou encore la numérisation intégrale des listes électorales s’inscrivent dans les recommandations faites par des observateurs nationaux et internationaux (Rapport de la Mission d’Observation de l’Union Africaine, 2018). Ces mesures viendraient consolider les efforts déjà réalisés et renforcer la légitimité du vote populaire.
Comment renforcer l’État de droit et l’indépendance judiciaire ?
L’État de droit constitue un socle fondamental de toute démocratie. Le Cameroun, qui a inscrit dans sa Constitution la séparation des pouvoirs et la soumission de tous — y compris les dirigeants — à la loi, a entrepris plusieurs réformes juridiques et institutionnelles dans cette direction. L’adoption du nouveau Code pénal en 2016, ainsi que la création de juridictions spécialisées telles que le Tribunal criminel spécial (TCS), témoignent de cette volonté de modernisation du cadre judiciaire.
Cependant, des défis subsistent quant à l’indépendance effective des magistrats, à l’accès à une justice équitable pour tous, et à la rapidité des procédures judiciaires. L’amélioration des conditions de travail dans les juridictions, la formation continue des magistrats, ainsi que la révision du statut du Conseil Supérieur de la Magistrature, afin de garantir sa neutralité, sont des propositions souvent évoquées.
Des initiatives telles que la Stratégie Nationale de Développement 2020–2030 (SND30) insistent sur le renforcement de la gouvernance et de la justice, ce qui confirme que le pouvoir exécutif a pleinement conscience de l’importance de cette réforme. En outre, l’intégration des nouvelles technologies dans la gestion des dossiers judiciaires — dans le cadre du projet e-Justice — pourrait accélérer les procédures et accroître la transparence.
Il serait également pertinent d’encourager la création d’un Observatoire National de l’État de Droit, réunissant des universitaires, juristes, institutions publiques et représentants de la société civile, afin de suivre les avancées et recommander des améliorations régulières.
Décentralisation et participation citoyenne : les clés d’un avenir démocratique
La décentralisation apparaît aujourd’hui comme un levier essentiel pour rapprocher la gouvernance des citoyens. Le Cameroun a consacré la décentralisation dans sa Constitution de 1996, et cette dynamique a connu une accélération avec la mise en œuvre du statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, ainsi que la promulgation en 2019 du Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées.
Ces avancées témoignent d’une volonté politique de confier plus de responsabilités aux collectivités locales. Toutefois, l’effectivité de cette décentralisation reste tributaire de la capacité des communes à mobiliser des ressources, à recruter du personnel qualifié et à répondre aux attentes des populations. La question du transfert effectif des compétences et des moyens financiers demeure centrale.
Par ailleurs, l’implication des citoyens dans la gestion des affaires locales peut être renforcée à travers la mise en place de plateformes numériques participatives, les budgets participatifs, ou encore la promotion des conseils de quartier. Ces mécanismes permettraient aux populations de suivre les projets communaux, de proposer des initiatives et de contrôler l’action des élus locaux.
L’État pourrait aussi favoriser la création de Maisons de la Citoyenneté dans chaque région, véritables lieux d’échange entre administration et citoyens, pour encourager le dialogue local, la formation civique et l’éducation à la citoyenneté.
La gestion des tensions sociopolitiques : dialogue national ou répression ?
Le pluralisme politique, acquis depuis les années 1990, s’est accompagné de tensions parfois vives entre les différents courants d’opinion. Les revendications dans les régions anglophones, les manifestations sociales liées au coût de la vie ou à la gouvernance, et certaines crises sécuritaires posent des défis importants pour la cohésion nationale.
Face à ces enjeux, le gouvernement camerounais a montré une volonté de dialogue à travers le Grand Dialogue National d’octobre 2019, initiative saluée par de nombreuses institutions internationales. Ce forum a permis d’ouvrir un espace de discussion sur les causes profondes des tensions et d’envisager des solutions durables, notamment à travers la mise en œuvre du statut spécial, le bilinguisme renforcé, et la promotion du vivre-ensemble.
Cependant, pour que ces initiatives produisent un effet durable, elles doivent s’inscrire dans une logique d’inclusion permanente et de concertation continue. Le dialogue ne peut être perçu comme un événement ponctuel, mais doit devenir un mécanisme institutionnalisé. Cela pourrait passer par la création d’un Haut Conseil du Dialogue National, organe indépendant chargé de recueillir les doléances, de formuler des recommandations et de suivre leur application.
La gestion sécuritaire des manifestations, quant à elle, gagnerait à être réformée dans un esprit de respect des libertés publiques. Une meilleure formation des forces de maintien de l’ordre en matière de droits humains, ainsi que la création d’une Commission indépendante d’observation des libertés publiques, contribueraient à concilier sécurité et liberté d’expression.
Conclusion : Vers une démocratie résiliente et participative
Le Cameroun n’est pas figé dans son évolution démocratique. Au contraire, les dernières décennies ont vu naître de nombreuses réformes institutionnelles, qui méritent d’être saluées. C’est sur cette base que doivent être bâties les prochaines étapes : une réforme électorale plus inclusive, une justice plus indépendante, une décentralisation réellement opérationnelle, et un dialogue politique permanent.
L’objectif n’est pas de nier les défis, mais de les aborder avec lucidité et engagement, en tirant parti des acquis existants. La volonté politique exprimée dans la SND30, les discours du Chef de l’État sur la jeunesse, la paix et la démocratie, ou encore les efforts en matière de gouvernance locale, sont autant de signes que les fondations sont posées.
Il appartient désormais à tous les acteurs — pouvoirs publics, partis politiques, société civile, diaspora, et citoyens — de s’inscrire dans une dynamique de co-construction démocratique. L’avenir de la démocratie camerounaise repose sur une vision partagée, une action concertée et un engagement résolu en faveur d’un développement juste, durable et inclusif.
👉 Un livre bientôt disponible explorera en profondeur ces questions, avec des analyses historiques, politiques et économiques rigoureuses. Il s’intitulera « Cameroun : Une Démocratie en Voie de Développement ».
📬 Si vous souhaitez recevoir des contenus exclusifs, être informé dès la sortie du livre et accéder à des réflexions inédites sur la gouvernance et le développement du Cameroun, inscrivez-vous dès maintenant à notre newsletter. Vous ferez partie des premiers à découvrir cette œuvre scientifique destinée à tous ceux qui croient en un Cameroun plus juste, plus fort, et plus uni.
Références :
- Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées (2019)
(https://www.prc.cm/fr/actualites/actes/lois/4050-loi-2019-024-du-24-decembre-2019-portant-code-general-des-collectivites-territoriales-decentralisees?utm)
- Constitution de la République du Cameroun (1996)
(https://www.prc.cm/fr/le-cameroun/constitution?utm)
- Discours du Président Paul Biya, Grand Dialogue National, octobre 2019
https://www.prc.cm/fr/actualites/discours/3776-message-du-chef-de-l-etat-a-la-nation-10-sept-2019?utm
- Loi n°2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code pénal camerounais
https://www.prc.cm/en/news/the-acts/laws/1829-law-no-2016-007-of-12-july-2016-relating-to-the-penal-code?utm
- Rapport de la Mission d’Observation de l’Union Africaine sur l’élection présidentielle (2018)
Ecrit par Vitalis Essala – Vitalis est pasteur-aumônier, auteur et analyste en gouvernance. Il écrit sur la démocratie, le développement et la résilience émotionnelle.